Réédition Omnibus "Bouquins", Robert Laffont 1985
Première édition (je pense..!) Casterman ed. 2000
« M’as-tu vu en cadavre ? » (1956) est, sous la plume de Léo Malet, le sixième épisode des « Nouveaux mystères de Paris » mettant en scène le détective privé Nestor Burma qui « met le mystère KO ». Une enquête de plus au sein de la capitale (il y en aura 15), une par arrondissement (tous n’auront pas leur part). C’est, pour l’instant, avec « M’as-tu vu en cadavre ? », le tour du Xème, dans le sillon du scintillant et parfois véreux show-biz, du music-hall à paillettes et light-shows, des chanteurs de charme en chasse de minettes énamourées ou de femmes mûres délaissées, des agences troubles d’impresarios, du Milieu aux aguets (on s’y « dessoude » armes à feu au poing). L’atmosphère ambiante est en rebond des années 50’s urbaines, du début des Trente Glorieuses mâtinées truands et porte-flingues. Burma y récolte, sous les portes-cochère des coups de matraque en caoutchouc ; déambule, sur le fil de son enquête, de bistrots en bistrots (Suze ou Saint-Raphaël, Pernod, Ricard, demi-pressions et petits noirs) ; s’arme en fond de poche d’imper d’un révolver (pas d’un pistolet, s’il vous plait, il a son standing) ; se saoule jusqu’au bout de la nuit en compagnie d’une vielle gloire fanée de la chanson réaliste. Le prologue, comme attendu, s’amorce dans son « Agence Fiat-Lux » via Auguste Colin dans la vraie vie, alias Nicolss de pseudo de music-hall dans le roman ou Nikolson (avec un K) dans la BD. L’homme, un vieil artiste fauché, depuis longtemps sans cachet, vient taper Hélène, la secrétaire, de 50000 balles. Burma s’étonne mais, bien entendu, raque et enquête, on ne la lui fait pas… La suite appartient aux nombreux rebondissements à venir. Les cadavres (6) pleuvent … Malet n’en est pas avare ; la conclusion se fera en huis-clos, démontant dans les détails les mécanismes de l’affaire, à la manière d’Agatha Christie (seule concession au roman policier classique). Sinon c’est du polar noir bon teint, et du bon ; Malet écrit bien … sans oublier de nous faire sourire. Héléne prend le « je narratif » le temps de deux chapitres, en écho de lieux où le détective ne passerait pas inaperçu ( ?????).
En 2000, Jacques Tardi adapte en BD « M’as-tu vu en cadavre ? », c‘est son 4ème Nestor Burma. Sous le bras, dans son carton à dessins, il livre 60 planches à son éditeur Casterman, 60 feuilles fignolées au poil de pinceau près ; le tout, comm’dab, en noir, blanc et gris assortis ; l’encre de Chine noire colle tip-top à la sombre ambiance embarquée, même si l’humour, plus qu’à l’ordinaire, est au rendez-vous. On est en pays de polar noir us des 30’s, le tout mâtiné franchouillard. Octobre 1956, Paris, 10ème arrondissement, en visite guidée. Gare du Nord, Canal Saint-Martin et Hôtel du Nord (si si.. !), Rue de Paradis, Passages du Désir et de l’Industrie. Tout baigne dans les années 50 made in France et quelques fois US. Stetson et gabardine col relevé sous la pluie pour Nestor, duffel-coat et noire jupe droite en-dessous du genou pour sa chaste (ou pas.. ?) secrétaire (on ne saura jamais s’il couche avec elle, et portant çà démange de savoir). Jambons-beurre, ballons de rouge, Ricard dans tous les bistrots qui passent. Boulets d’anthracite glissés par les charbonniers dans les soupiraux en ras d’immeubles. Machine à écrire Underwood au clavier qui cliquette. Cartons bristol à la prose lyrique: « Nikolson, acteur et fin diseur des concerts parisiens », « Soirées, mondaines, concerts, music-halls, tournées, France et étranger » ; concierge dans l’escalier ; hirondelle à pélerine et bicyclette, scooter vespa ; photographies Harcourt, réveille-matin mécanique qui grelin-grelin, affiches de starlettes affriolantes, banquette moleskine dans les troquets, électrophone Teppaz et 78 tours éparpillés… Arpentent le bitume ou le pavé mouillé : rondes 2CV, 4L, DS 21, arondes, dauphines, 203 Peugeot, tubes Citroën, hommes à chapeaux mous, femmes à fichu, filoche à baguette et légumes des 4 saisons. Postes TSF dégoulinant de sirops radiophoniques (« Gondole d’amour, ivresse des plaisirs ; gondole d’un jour, pont des soupirs », téléphones d’antan de noire bakélite et de chromes montés, cendriers Byrrh ou Ricard dégorgeant de mégots écrasés et tire-bouchonnés, affiches à pulpeuses starlettes de music-hall, bistrots et garçons de café torchon à l’épaule, Suze et eau de seltz. Petites annonces journaux : concert « Count Basie », « dans votre salle préférée le « Monde du silence » de Cousteau ».
Vrai… ! Un grand moment que ce roman et cette BD. Lectures couplée, de proche en proche, de page en page. L’expérience amorcée avec « 120 rue de la gare » est à renouveler avec « Casse-pipe à la Nation ».

%2002.JPG)
%2003.JPG)
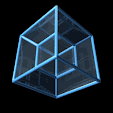

%20&%20Tardi%20(BD).JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
%20&%20Tardi%20(BD)(double%20page%20inside).JPG)








.JPG)

