Gallimard - Futuropolis (2011)
En 1972, Jean-Patrick Manchette fait paraître en
Série noire, sous le n°1489, son
troisième roman: "Ô Dingos, Ô
Châteaux" après "Laissez
bronzer les cadavres" et "L'affaire
N'Gustro". L'auteur, à mon sens, n'est pas encore à son zénith. Ses
meilleurs titres viendront plus tard avec en 1976, "Le petit bleu de la côte ouest", et en 1981, "La position du tireur couché".
Tardi nous offre l'adaptation BD
de "Ô Dingos, Ô Châteaux" en
2011 et signe un chef d'oeuvre.
En
dessinateur émérite mais scénariste de moindre efficacité, il est sans cesse à
la recherche d'âmes soeurs de talent, lui aux pinceaux et les autres au
clavier. Manchette et lui, par
exemple, en duo de rêve, "Griffu"
(1977) en est la preuve, auraient pu avancer, main dans la main, si la maladie
n'avait pas emporté, trop jeune, le romancier. Leur avenir commun était tout
écrit: Manchette, en scénariste, la
tête perdue dans les cliquetis incessants de la machine à écrire et Tardi, en dessinateur de génie, les
pieds dans l'encre de Chine noire, les doigts armés du crayon papier et de la
gomme. Mijotaient en eux les mêmes horizons politiques, les mêmes haines, les
mêmes (des)espoirs, la même noirceur politique colérique.
Si l'on
regarde les profils des scénaristes avec qui Tardi collabora, on constate que, peu ou prou, ils furent tous
taillés dans la même mouvance d'idées et d'univers, la même (in)compréhension
du monde: Daeninckx, Vautrin, Pennac, Manchette ... D'autres écrivains échappent
à cette complicité d'idées quand des cheminements différents conduisirent Tardi à s'occuper de Céline ou de Veran
...
Après le
mythique "Griffu" en
collaboration rêvée avec Manchette, Tardi, désormais sans le romancier à
disposition depuis son décès en 1995, adapte seul trois titres du maître du
néo-polar français. Ce sont trois hommages forcenés qu'il ira gratter au fond
de lui-même et au plus près des textes incisifs et percutants de Manchette. On trouve successivement en
BDs ; "Le Petit bleu de la côte
ouest" (2005), "La
position du tireur couché" (2010) et le présent "Ô Dingos, Ô Châteaux" (2011). Le dessinateur ira jusqu'à
les regrouper en triptyque, dans un coffret grand luxe. Ce qui assemble les
trois ouvrages BDs est évident, ils suivent la même veine sanglante, la même
brutalité sans fard, des destins quasi identiques de héros taillés dans les
mêmes moules de déveine et de marginalisation. Et au-delà, le lecteur sent que
le dessinateur a voulu rendre hommage à un écrivain d'importance et surtout à
l'homme qu'il fut. Il y a du respect derrière chaque trait de plume, dans
chaque vignette.
Le dernier album paru, "Ô
dingos, Ô châteaux" suit un scénario simple: un road-movie sanglant et
brutal confrontant une jeune marginale névrosée en fuite face à un tueur à gages psychopathe à ses trousses. Tardi reprend quasi à l'identique le déroulé
de l'intrigue, les variations sont mineures, relèvent du détail, de la
nécessité de ramasser encore plus l'intrigue sur elle-même. Le texte de Manchette est souvent repris à la
lettre, au mot près. Certaines phrases tirées intégralement du roman étaient si
fortes que Tardi n'a pu s'en passer:
"Le
projectile de 11.43 mm
entra sous les côtes de Bibi, fit éclater le foie et ressortit par la
fesse."
Une nouvelle fois, Tardi utilise son traditionnel noir et
blanc. Les contrastes sont appuyés, sans guère de gris intermédiaires. Tout est,
au final, noir ou blanc. Le background n'est rien, simplement blanc et neutre,
banalement évoqué. Le noir absolu de l'encre de Chine dessine les hommes au
pire d'eux-mêmes, en écho à la noirceur de leurs actes.
Tardi recrée dans
le détail les backgrounds urbain et campagnard des années 70. Manchette, dans
sa frénésie neo polar minimaliste ne s'y était que peu astreint dans le roman.
Pas grave. , comme à son habitude, Tardi
se fait plaisir et utilise une documentation énorme. On croise le Lyon et le
Paris d'alors; ma campagne du Massif Central, celle inchangée que je
n'échangerai plus contre les arbres gommés du béton. On y trouve des képis
d'agents de police effacés de ma mémoire; une Simca 1500 d'un temps révolu,
celle verte que conduisait mon père; les étals d'un super-marché où l'on
cherche les échos consuméristes du passé; le design typique d'un mobilier
d'époque étonnant; une DS de chez Citroen; la rondeur rassurante d'une
Coccinelle de Volkswagen; une Micheline de la SNCF..... et, surtout, ces armes
de poing d'antan que Manchette
(hélas..!) vénérait.
Tardi a une
manière toute particulière de dessiner les yeux. Deux simples points noirs
minuscules les matérialisent. Rien de plus. Ce minimalisme qui les rétrécit à une
quasi absence étonne. Sont t'ils même ouverts derrière les lunettes en verre
miroir qui les cachent parfois ? Le regard du tueur à l'oeuvre du meurtre à
gages, ainsi réduit à sa plus simple expression, devient neutre, froid, vide, impersonnel,
impavide, effacé de toute humanité, gommé de tout remords de la mort imminente qu'il
promet. Le lecteur n'y lit rien si ce n'est la seule certitude d'une mort
désormais à l'oeuvre. Tout, ainsi, peut arriver derrière ce que Tardi ne montre pas. L'incertitude de
survie, tuer ou être tuée, conduit la victime à la même froideur d'âme,
chasseur et chassée se ressemblent dans la traque: le même regard s'impose.
L'oeil renvoyant l'âme, Tardi
se passe volontairement de moyens graphiques reconnus pour donner du relief
psychologique à ses personnages. Je n'ose imaginer qu'il ne soit pas capable
"de rendre" un regard. L'intention est, à mon avis, délibérée quand
l'effet est, au final, foudroyant. Les personnages-mystères à l'oeil minimal tendent
jusqu'à la rupture l'arc dramatique du récit, l'action est sans arrêt comme
suspendue entre deux moments d'incertitude.
Si les yeux ne parlent pas, l'empathie du lecteur à l'égard
des personnages fonctionne à plein. Quels sont les mécanismes à l'oeuvre pour
qu'une telle alchimie se réalise, pour que l'intégration du lecteur dans le
récit soit si forte ? Quelque chose dans les phylactères, dans l'emprunt au
texte original de Manchette ?
Peut-être ? Même si tout se complique quand on sait que l'écrivain ne
s'épanchait pas vraiment sur les ressorts psychologiques de ses héros, laissant
place libre aux seuls faits. Je ne sais pas expliquer cette magie, et pourtant
elle est là, scotche le lecteur à la force brutale qui se dégage des vignettes.
Tardi rend copie d'un chef d'oeuvre
alors que le roman original n'en était pas un. Etonnant renversement de
situation.
A l'occasion du violent règlement de comptes final, Tardi nous offre dix dernières pages
apocalyptiques où l'attention du lecteur, j'allais dire du spectateur, se
focalise, presque à défaut de textes, sur un déroulé presque cinématographique
des vignettes. On est ici en terrain du 25 images/seconde; le réalisateur ciné
que devient Tardi y montre toute
l'ampleur de son talent. Chapeau..!
La police n'est qu'ombre au tableau, en son absence on est
en pays de polar, de neo polar même quand l'hyper-violence règne sans retenue,
quand les faits violents se bousculent l'un l'autre à un rythme diabolique. Tardi avait pris l'habitude, dans
d'autres BDs, d'user d'encre de Chine rouge pour surligner la dramaturgie des
blessures; ici il n'en fait rien: tout
aurait été rubicon.
Tardi, une
nouvelle fois, choppe son lecteur et l'emmène loin, au-delà de la simple
lecture récréative d'une banale BD, vers un univers sombre où la bonté n'a que
peu de place, vers celui, violent et fracassant, où l'humain ne promet rien si
ce n'est la mort au bord du chemin.

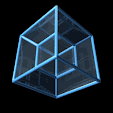



+Malet%20(Roman).JPG)







_ « Tardi nous offre l'adaptation BD de "Ô Dingos, Ô Châteaux" en 2011 et signe un chef-d’oeuvre. »
RépondreSupprimerContent que ça t’ait autant plu. ^^
Des trois adaptations de Manchette par Tardi, c’est celle que j’ai préférée.
_ « Tardi recrée dans le détail les backgrounds urbain et campagnard des années 70. (…) Tardi se fait plaisir et utilise une documentation énorme. »
Et ces bandes dessinées gagnent à leur tour, en background des aventures échevelées, une qualité documentaire.
Le choix des objets, des types de bâtiments, posés là simplement, sans ostentation, est remarquable.
« _ Dis Tonton, ça ressemblait à quoi, la France, à l’époque ? _ Ben, tiens, regarde… »
_ « Tardi a une manière toute particulière de dessiner les yeux. Deux simples points noirs minuscules les matérialisent. Rien de plus. Ce minimalisme qui les rétrécit à une quasi-absence étonne. (…) L'incertitude de survie, tuer ou être tuée, conduit la victime à la même froideur d'âme, chasseur et chassée se ressemblent dans la traque: le même regard s'impose.L'oeil renvoyant l'âme, Tardi se passe volontairement de moyens graphiques reconnus pour donner du relief psychologique à ses personnages. Je n'ose imaginer qu'il ne soit pas capable "de rendre" un regard. L'intention est, à mon avis, délibérée quand l'effet est, au final, foudroyant. (…) »
Très intéressant, tout ça… !
_ « A l'occasion du violent règlement de comptes final, Tardi nous offre dix dernières pages apocalyptiques où l'attention du lecteur, j'allais dire du spectateur, se focalise, presque à défaut de textes, sur un déroulé presque cinématographique des vignettes. »
Tout à fait. Je pense à certains cinéastes qu’appréciait Manchette, comme Samuel Fuller ou Robert Aldrich, auraient pu en tiraient de grandes scènes (Boisset a choisi une autre fin).
Jim, citation: "Boisset a choisi une autre fin"
Supprimer>>>> Tu connais ma culture ciné, elle est assez maigre. Il m'a fallu gratter le net pour trouver "Folle à tuer", je connais Boissey (encore que..!) et Jobert. Je pense n'avoir jamais vu le film. Ce qui laisse en point d'interrogation ton propos et me pousse à te demander: "çà fini comment chez lui..?"
Dans Folle à tuer, le château des alpages devient une grande propriété dans la vallée, le riche industriel y reçoit la police, le tueur (vite dézingué) puis la fugitive, que les forces de l'ordre ne croit pas jusqu'à ce que le gosse mette la main sur des preuves mal brûlées dans l'âtre.
SupprimerMême si Michael Lonsdale, citant le chat du Cheshire dans sa dernière scène, est amusant, c'est quand même une fin décevante, trop facile au regard de ce qui précède.
Ok, merci, l'industriel, en importance de rôle, supplante le statut de star du tueur à gages, c'est effectivement dommage.
Supprimerhttps://www.youtube.com/watch?v=ckp1IIlbXiw
RépondreSupprimerL'extrême bout de la vidéo révèle une anecdote étonnante qui fait trace sur la BD.
Alors là... 'fallait vraiment être familier du bonhomme pour le reconnaître.
Supprimer(C'est pas ce Tardi-Manchette-là qu'il y a, dans un présentoir de Tabac-Presse ou supermarché dans bouquins de Manchette ?
J'aurais bien imaginer l'écrivain dessiné en client y jetant un œil dédaigneux et grommelant : "Pff! Littérature de gare..." ^^)
"Ô Dingos Ô Chateaux", 3ème volume, de la série met en scène l'incendie du super-marché à l'égal de la station-service dans "le petit bleu de la côte ouest". Page 63 on a un présentoir qui nous montre version BD les deux premiers éléments de la trilogie.
SupprimerJe plussoie sur le fait que Manchette dans la video ci-dessus n'est pas reconnaissable mais si Tardi lui-même le dit. Lol.