BD : Casterman, probable édition originale de 1996 - Roman : Omnibus ed., réédition 1987
Tardi nous régale ici, une fois de plus, de son graphisme pointilleux en noir et blanc. Le voici, en adaptant « Casse-pipe à la Nation », de retour au service du romancier Leo Malet via son détective privé de fiction, Nestor Burma. C’est la troisième BD de la série, il y en aura quatre ; les suivantes appartiendront à d’autres scénaristes et dessinateurs « d’après les personnages de Tardi ». Dans cet épisode, et peut-être plus que dans tout autre, Paris et ses habitants, encore et encore, prennent la lumière sur la planche à dessins de l’illustrateur.
Nous sommes, à la fin des années 50, dans le douzième arrondissement, entre la Gare de Lyon, la Place de la Nation et les entrepôts vinicoles de Bercy.
Mai sur Paris est à la pluie à grands tirets obliques, au pavé mouillé et luisant, aux lumières de la ville réfléchies dans l’eau-miroir des caniveaux.
Au hasard des vignettes, en fouillant les détails du background, se dessine une époque pas si lointaine que çà, celle de la première décennie des Trente Glorieuses. La restituer ainsi aura imposé un travail de documentation considérable et un amour immodéré des rues de la capitale.
Colonnes Morris plantées au mitan des trottoirs. Badauds au côte à côte sous le ventre de leurs parapluies ouverts. Au ciné, le long d’un boulevard, « Le faux coupable » d’Hitchcock est à l’affiche. Des BB électriques de la SNCF attendent sous les verrières de la Gare de Lyon. « C’était mieux du temps de la vapeur » se chuchote Burma.
Du monde, jambes croisées, à la terrasse des cafés ; bières pression, ballons de rouge et petits noirs sur le marbre froid des tables de bistrot. Hirondelles à pélerine et bicyclettes ferraillant le long des trottoirs ; panier à salades au pied d’un commissariat. « L’Algérie aux algériens » en noirs graffitis sur les murs, en unes des quotidiens ou des périodiques : « Paris-Presse, l’Intransigeant », « Détective », « France-Soir » ou « Paris-Match ». Des Peugeot 203, des Panhard, des 4CV, des Juva 4, des Citroën traction avant, des bus à plateforme et contrôleur embarqué, des 2CV camionnette, Scooters Vespa et ID19…. Tout un parc automobile aujourd’hui disparu du macadam.
Un soir de mai, Nestor Burma, l’esprit chagrin, vient de se faire poser un lapin, Gare de Lyon, par sa secrétaire de retour de vacances dans le Midi. A la Foire du Trône voisine, il suit une inconnue d’attraction en attraction. La brune sexy monte dans le Grand Huit ; Burma suit, se case derrière elle dans le wagon. Au zénith des circonvolutions, on l’attaque violemment par derrière ; il éjecte son agresseur dans le vide, l’homme s’écrase trente mètres plus bas. La police s’en mêle, qui pour vouloir le tuer ?
Ainsi commence le 3ème épisode BD (le 12ème roman) des Nouveaux Mystères de Paris de Leo Malet adapté par Tardi.
Bidasses en uniforme, au casse-pipe forain, l’œil dans l’alignement de la carabine, petits plombs tirés pour le gain d’un ours en peluche ou d’un filet garni. Auto-tamponneuses aux formes arrondies, carapaçonnées de chromes rutilants, puces chahuteuses sous les gerbes d’étincelles en bout de perches griffant leur ciel électrique. Barbes à papas, guimauve, nougats, pommes d’amour, pralines, gaufres et crêpes. Loteries, « Ici, pas de perdants » braillé à tue-tête. Ballons de baudruche en grappes. Le « Grand Huit Infernal » campe au-dessus de la mêlée, tel un gigantesque squelette de dinosaure couché, vaincu, privé de chair ; ses wagons ferraillant le long de la courbe des côtes, sous les hurlements des midinettes et les dents serrées des hommes.
Via l’excellence du graphisme en noir et blanc, on perçoit au fil des pages les cris, les éclats de rire, les airs bastringue des orgues de Barbarie. Tardi se régale à nous montrer la fête foraine et son étourdissant foutoir, la foule insouciante et heureuse en ces instants suspendus, tout un joyeux capharnaüm assourdissant.
Gamins, gamines, papas, mamans, beaux gosses aux bras de starlettes d’un soir, blousons noirs cloutés et gominés, pince-fesses et cherche-midi. Grande roue, chenille, chevaux de bois et balancelles aériennes ; loteries et confiseries ; cartomanciennes ; Hercules de foire et monstre de Java bouffeur de feu.
Ailleurs, de nuit, loin de la fête et sous la pluie, les façades borgnes en pignons de rue, les tristes maisons de pierre, les terrains vagues, les rues désertes, les wagons-citernes où attend le vin ….
L’intrigue est complexe, tissée d’évènements disparates mais convergents ; le déroulé suit les codes du polar noir US où un détective privé cherche à s’affranchir de l’enquête policière, où un héros désabusé se moque largement de ses contemporains. Burma aura fort à faire. Des personnages récurrents : le commissaire Faroux, le journaleux Covert … D’autres pour l’occasion : une paraplégique, une fille à papa, un « pinardier », un Hercule de foire, des loubards bagarreurs, de l’or en magots, des truands, une cuve à vin….
L’adaptation BD, comme à l’ordinaire, est très fidèle au roman, embarque de gros morceaux du roman, emprunte au parler populaire, se gonfle d’humour argotique, crée épisodiquement ses propres répliques comme lorsque Burma compare son revolver à « un vrai morceau de la croix du Christ ».
D’autres Tardi m’attendent.
Finie la Foire du Trône. Dommage. Les annonces foraines s’estompent dans la
nuit : « En voiture, en voiture pour un nouveau départ »,
« Roulez, roulez, roulez, roulez jeunesse » ; « En
voiture s’il vous plait ».
PS : dans la série culte des
« Maitres du Mystère », une adaptation radiophonique (1958) du
roman est accessible sur You Tube. On y retrouve la patte radiophonique caractéristique
des ondes moyennes des 50’s et des 60’s, ces voix d’acteurs restées dans les souvenirs
d’enfance de celles et ceux qui ont connu cette époque.
+Malet%20(Roman).JPG)
.jpg)
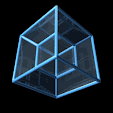

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)


.png)
.jpg)



+Malet%20(Roman).JPG)






