Réédition "Livre de Poche". La première édition en "Presses de la Cité" date 1956
Elle et lui …
Lui, Maitre André Gobillot, homme de robe réputé, la quarantaine finissante, qui en « Je narratif », présente, ici, ses confessions intimes… au regard du drame qui s’annonce et dont il est un des acteurs.
Depuis un an, sa vie privée, sa vie tout court par effet rebond, se découd point après point, et ce jusqu’à l’irréparable accroc. La faute à une jeune femme, sa maitresse inconstante, une délinquante qu’il a fait acquitter, qui lui cause tracas que la raison aurait pu éviter. Voici le récit des faits et circonstances, des causes et conséquences d’une perte de contrôle sur la vie. Le lecteur se fera juge du drame en cours jusqu’à sa conclusion fatale, et selon ses convictions prendra position ; « Un homme nu » (cher à Simenon) passe à confesse, se raconte pour mieux s’expliquer ; un être diminué et rongé peu à peu se dessine dans ses faiblesses et défauts pour mieux se détruire.
Début des 50’s, sous les ors de la Quatrième République, André Gobillot est un avocat parisien de renom, pugnace et peu regardant sur les moyens (quitte aux connections avec la mafia, aux faux témoignages et à la caricature des victimes quand il s’agit de faire innocenter un coupable) ; c’est un homme de robe qui, loin de la veuve et de l’orphelin, défend, invariablement avec succès, ses pairs de la Haute Société égarés dans des affaires crapuleuses, le plus souvent financières. Gobillot : un fauve oratoire, aidé par son épouse en un duo implacable et vénal, qui sous le couvert de la légalité, se vante d’acquittements injustifiés là où d’autres n’arrachent rien, ou au mieux des non-lieux.
Il se perçoit, ses mots sont durs, gras, petit et laid, homme sans attrait si ce n’est via l’image de pouvoir qui est sienne, presque comme une vengeance sur le sort. Un mariage de raison ou peu s’en manque ; des passades amoureuses clandestines sans lendemains, ni envie ni plaisir ; une vie mondaine dans l’entre-soi, autarcique et sans éclats ; un dédain assumé et pitoyable de lâcheté des classes subalternes (sa secrétaire, qui se sent des faiblesses pour lui, amoureuse transie et silencieuse, se voit sans cesse rabrouée). En filigrane de ses confessions, sans qu’il se l’avoue vraiment, on perçoit un être détestable et vil, centré sur l’argent qui peut tout et le pouvoir à n’importe quel prix, qui fait plier autrui.
Une vie réussie à l’aune de ses critères ? Va savoir ! Il suffit parfois d’un détail, d’un grain de sable… pour qu’en boomerang …
Elle, Yvette Maudet. Auteure maladroite d’un hold-up minable, de plus raté. Gracieusement, Gobillot plaidera sa cause et la fera acquitter en échange de certaines faveurs. Trajectoire classique d’une jeune et belle provinciale des 50’s, montée à Paris sans argent, en rupture familiale, qui veut croquer la vie jusqu’à plus faim. Une belle plante, immorale et sensuelle, bientôt à fleur de bitume si elle n’y prend pas garde ; qui plus est écervelée et autocentrée, entre innocence et cynisme, au cœur d’une naïveté de façade, elle entrevoit les écueils de son avenir et les moyens, via son physique, de les contourner. Suffit de jouer serrer et de voler les âmes mâles qui gravitent à sa portée. Une femme entretenue, à dispo, néanmoins empathique et reconnaissante. Un amant de cœur, un autre de raison par qui l’argent vient et se disperse dans les cabarets, restos en vue et boites de jazz à la mode. Pour elle, Gobilot ou un autre, peu importe, sur le fil des circonstances. Un mix classique, invariablement détonnant quand l’amour peu partagé s’en mêle. Gobillot possède le physique d’Yvette mais n’atteint pas son âme.
La suite appartient au récit …
Une critique de la haute bourgeoisie à la toile émeri ; un double portrait à l’acide qui fera les choux gras de Claude Autant-Lara adaptant le roman en 1958. Un film où s’attisent certaines des caustiques obsessions sociales du réalisateur, bien avant qu’il ne plonge dans les eaux sales d’un déni historique. Une scène d’anthologie : Bardot, provocante et sûre de ses charmes, soulevant sa jupe au coin d’un bureau ; Gabin, silencieux et les mains dans les poches, qui, dans la jeune chair entrevue, y perdra son âme. Côte à côte, face à face, la cohabitation inattendue de l’expérience ciné d’un Gabin à son apogée et la fragilité théâtrale, naïve et quelque-part trompeuse de Bardot, depuis peu promue au rang d’un mythe … qui créa la femme. Une scène-scandale, une censure qui pointe son nez, un film au sommet d’une époque. Le long métrage perd en fidélité d’adaptation quand il se détache de son schéma narratif premier, celui du journal intime ; l’introspection y faiblit, mais pouvait t’il en être autrement en 25 images/seconde ? Le scénario édulcore certains passages tout en restant assez fidèle au roman.
Le roman. Une prose plus dense qu’à l’ordinaire, malgré tout détachée et fataliste, inscrit dans le milieu aisé qu’elle décrit ; celle d’un homme cultivé qui sait manier les mots dans leurs complexités d’agencements. C’est, après tout, son métier. Peu à peu, sous des tournures de phrases de plus en plus fébriles, perce un décalage entre les artifices de façade et ses pensées, introspectives et souterraines…
L’épilogue, bien que prévisible, n’est pas celui que j’attendais. Il en existait une variante que Simenon et Autant-lara n’ont pas emprunté. Un drame est passé. Qu’en reste t’il ? … sinon un cadavre et un assassin ; un « homme nu » brisé, rongé jusqu’à l’os, miné, implosé, rendu à la justice et à sa femme ; son témoignage-papier, cet « en cas de malheur » comme une volonté de s’expliquer à postériori, de plaider sa propre cause et celle de quelqu’un d’autre, de se trouver des circonstances atténuantes … passez muscade, Simenon tire sur l’ambulance. Le destin sera sans pitié.
.jpg)
.jpg)
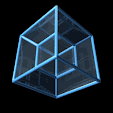

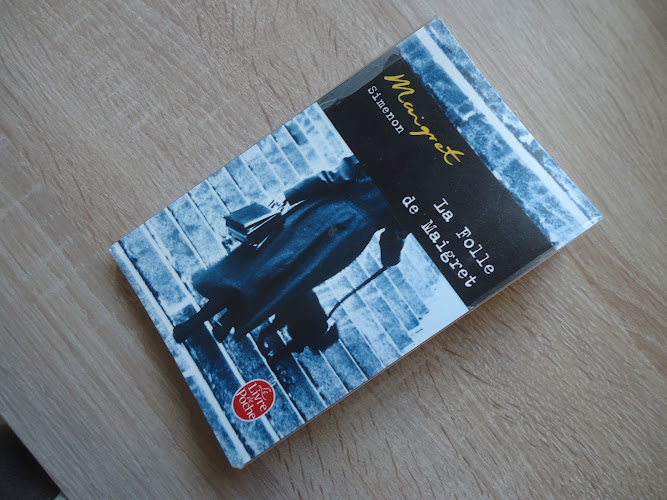

.jpg)
.jpg)








.JPG)

