Je viens de retrouver la chronique qui suit dans les tréfonds de
mon unité centrale. Elle date de 1999, soit 20 ans pile en arrière. Je ne me
souviens pas de l'avoir un jour écrit. Mais ma manière y est, bel et bien.
Qu'en faire ?
L'abandonner à son fichier word d'origine..?
L'insérer dans les commentaires de celle mis en ligne récemment sur
"La convergence des parallèles"
... où elle serait bien trop lourde à lire ?
Ouvrir un autre article en expliquant le problème ?
J'ai choisi la dernière voie car mon ressenti venu d'une autre
époque, j'avais alors 44 ans, ouvre d'autres fenêtres sur le roman, d'autres
trajectoires de réflexion que celles récemment abordées.
"Putain quelle claque !
Pas la petite, mutine, qui laisse le sentiment d’avoir lu un chef d’œuvre,
d’avoir passé un bon moment de littérature, d’en conseiller la lecture à un
ami…Non, la grande, la très émouvante sensation de côtoyer la vérité sur la
nature humaine, d’en sonder les profondeurs, de descendre, bas, très bas et de
ne pas en revenir indemne.
Durant
mon adolescence et beaucoup plus tard dans les années 90 j’avais vu le film, le
vieux film en noir et blanc, tiré de l’ouvrage. Probablement, les deux fois,
aux alentours des commémorations du 11 novembre 1918. Les images en étaient
fortes, très fortes, indicibles, effroyables, oniriques et pourtant si réelles.
Je m’étais promis qu’un jour ou l’autre le roman me tombant sous les yeux je le
lirai, confiant dans l’espoir que les lignes libéreraient des aspects
inabordables au cinéma : les sons, la couleur, les odeurs et les
sentiments. Je ne suis pas déçu.
Première constatation: pour le lecteur,
le héros d’un roman porte au fil des chapitres un visage bâti peu à peu au gré
des événements, des sentiments, des descriptions. Assez bizarrement celui du
héros d' "A l'ouest rien de nouveau"
reste un masque blanc de mannequin, surface mate d’impénétrabilité, sans yeux
ni bouche.
L’explication pourrait être de
deux sortes.
Virtuosité littéraire de l’auteur
qui aurait réussi à le rendre totalement anonyme, à poser « tout un
chacun » en héros potentiel, sans qu’aucune qualité n’ait été vraiment
nécessaire à ce « Monsieur tout le monde" pour participer au carnage »
sinon de se trouver là au mauvais moment, au mauvais âge, et à la mauvaise
heure. Ici, l’emploi de la première personne du singulier pour faire avancer le
récit renforce l’empathie du lecteur sur le héros.
Deuxième raison :
l’inconscient du lecteur fabrique ce masque afin de pénétrer davantage dans le
récit. A l’appui de mes dires un argument qui vaut ce qu’il vaut :
maintenant, à l’issue de la lecture je ne me souviens ni du nom ni du prénom du
narrateur alors que les noms de protagonistes accessoires remontent à ma
mémoire. Et pourtant je sais que quelque part au creux des pages se trouve le
patronyme recherché.
Etonnant et mystérieux !
Ou, peut-être que mes
constatations présentes ne me sont que propres et ne relèvent simplement que de
ma sensibilité qui n’est sûrement pas la même que chez un autre lecteur.
Deuxième constatation: les
protagonistes du roman sont allemands, mais, çà n’a en soit que peu
d’importance quand on sent qu’ils auraient pu être français, anglais ou russes.
De l’autre côté de la tranchée les situations, les sentiments, les colères, les
révoltes, les soumissions, les peurs, les morts ont été identiques, copies
conformes.
Troisième constatation: l’indifférence
masquant l'horreur, comme un remède au pire. Une seule chose compte: la survie.
Plus la mort du voisin est atroce, plus ce désir se renforce. Plus l’homme
reste longtemps dans les tranchées plus il s’enracine dans la volonté de durer.
Autre élément déterminant : cette faim atroce qu’il faut calmer à tout
prix, la douleur, la saleté, les parasites, les brimades ne sont
qu’accessoires. L’instinct de la bête remonte. Il faut tuer l'ennemi, et manger
pour survivre. Même ces jours heureux d’un passé enfui sont un piège qui
affaiblissent l’animal, il faut vivre avec son présent. Le héros décrit admirablement
son malaise au cours d’une permission où personne ne comprend vraiment ce
qu’est le Front.
Le
style de l’auteur alterne brillamment les scènes documents, le plus souvent
instants choc et horribles, et les phases d’introspection essentiellement
basées sur le fait que « le nord est perdu », que les valeurs ne sont
plus celles de l'arrière, celles d'avant, que l’amitié l’emporte sur les liens
familiaux, que le futur est une chose floue et totalement aléatoire qui n’a
plus aucun sens, que le passé n’existe plus, qu’il faut l’oublier sous peine de
s’affaiblir et d’en mourir.
J’ai
longtemps cru cette histoire récit bibliographique d’un quelconque
« poilu » allemand. Il n’en est rien : c’est un roman. Richement
documenté, basé sur des faits réels, mais regroupant sans doute des événements,
des souvenirs d’anciens. A ce titre le récit perd de sa force et de sa
puissance.
Que
penser de cette génération sacrifiée, qui à l’égal des futurs vétérans du
Vietnam, va se retrouver déposséder de sa jeunesse, de ses espérances, des
meilleures années de vie...? Que penser de ces éclopés du physique et du
comportement qui, encore en 1999, pour certains, promènent encore, chaque nuit,
des cauchemars de sang et de mort."


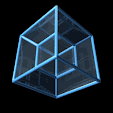



+Malet%20(Roman).JPG)







il y a 20 ans, tu étais donc un précurseur de l'esprit " Babélio" ;-)
RépondreSupprimeren tous cas tu étais déjà dans le schéma du développement minutieux de tes idées!
tu étais déjà dans le schéma du développement minutieux de tes idées!
RépondreSupprimer>>>>>>> :-) Que cela en est même un défaut..!
ben non, je sais pas pourquoi tu dis tjs ça.. c'est ton style c'est tout!
SupprimerL'Education Nationale d'antan a son poids là dedans. Pour aider, elle booste maladroitement en mettant le nez dans un "atipysme" à corriger, là où elle aurait mieux fait de l'encourager. Du coup je m'essaie sans cesse à me prouver à moi-même qu'elle s'y est mal pris. En conséquence c'est l’exubérance et un petit bout de ton esprit de synthèse ne serait pas de trop.
Supprimer