The Who est un
groupe rock londonien fondé en 1964.
Le line-up le plus durable et le plus ancré dans le renom
comprend:
Roger Daltrey: vocals;
Pete
Townshend: guitar;
John
Entwistle: bass;
Keith
Moon: drums
Les deux derniers sont décédés (1978 et 2002). Le quatuor
tourne et enregistre toujours.
"Live at Leeds"
est un album enregistré en concert à Leeds
le 14 février 1970. Il suit l'opéra-rock "Tommy" (1969) et précède "Who's next" (1971). C'est un élément discographique
incontournable de l'Age d'Or du quatuor et, sans nul doute, l'un des meilleurs
opus en public qu'enregistra jamais un groupe rock de cette génération. A l'égal de "Made in Japan" (Deep Purple) et de "Live at Fillmore East" (Allman Brothers Band).
Le renom justifié de "Live at Leeds" est né sous l'impulsion de deux facteurs:
Le premier est l'opportunisme commercial de sa mise en bacs,
pile poil au bon moment, un an à peine après celle de "Tommy". Dans la foulée de son
succès phénoménal s'imposait un banal "best of" ou un enregistrement
en public regroupant les meilleurs titres. Sauf qu'en contre-pied inattendu, choix
du live entériné, les emprunts aux opus précédents ne sont pas légion. Trois
reprises de bon vieux rocks, trois compos persos d'antan: le tour est joué.
"Live at Leeds" n'est pas
vraiment une compil des meilleurs succès sur scène, comme on avait alors
l'habitude de les monter, mais presque un album à part entière. Tout nouveau,
tout beau, propre comme un sou neuf.
Doctor Studio &
Mister Live.
L'objectif du groupe est autre. Il veut montrer sa face
cachée, celle live encore peu connue d'un quatuor qui cogne fort face au public
venu l'entendre. The Who monte sur
scène comme sur un ring, à la recherche du KO sonore. L'explosivité est sa
nature profonde, son âme. Elle n'est guère perceptible au coeur de la
sophistication des efforts studio mais éclate à retardement sous les lightshows.
Le 33 tours est l'écho
magique de la fureur sonore cataclysmique que délivrait alors le groupe sur
scène. On y trouve, semble t'il peu remixé, ce que The Who proposait en concert à l'extrême bout des 60's. Toujours est-il
que des rumeurs prétendirent que l'opus n'était pas live mais mijoté en studio;
l'hypothèse de la triche fut démentie par la parution du show en entier il y a
quelques années (cette version est hautement recommandable) et celle d'un
concert de réserve, celui d'Ulm le lendemain, jugé moins réussi.
Le projet live de "Live
at Leeds" est, à l'époque, un pari commercial peu risqué. L'exercice
étant prisé d'un public avide de messes païennes collectives, le fan achète
d'enthousiasme*. "J'y étais" pour
certains, "J'aurais pu" pour
d'autres, "J'aurais du" et "Si seulement..." pour les derniers. L'album se
prive des pièces maîtresses de "Tommy",
en chasse l'aspect studio trop bien
léché. Le tout est en outre brut de décoffrage. Les scories et impuretés
sonores sont bien lisibles, les chansons sont peu corrigées des fausses notes
et approximations musicales. Au diable le perfectionnisme et bienvenue à l'envie
de jouer dans la spontanéité jubilatoire.
On touche ici l'âme du rock, à son essence, punch et feeling,
défonce et headbanging, urgence et improvisations.
Les Who sur scène
comme si vous y étiez.
Le rock supporte l'à peu près musical, c'est sa plus grande
force, et là les Who sont en forme,
leurs erreurs plaisent et apparaissent traits de génie.
Combien d'efforts rock en live sont tombés à l'eau de part
la volonté de trop post-produire. Les overdubs stérilisent l'instantanéité, on
ne croit pas à la vérité de shows sans défauts.
Les Who avaient
réputation sur scène de secouer les corps, pas de poser réflexion philosophique
autour d'un rock progressif intellectuel, le but était de frapper fort dans
l'essentiel, no concession no fioritures.
Et au final, ce live: quelle P**** de claque in the gueule..!
Sortez l'aspirine, c'est à headbanger en direct face au mur.
C'est d'abord un miracle de prise de son. Les trois
instruments et la voix sont bien séparés, isolés et compartimentés dans les canaux
droit et gauche de la Hi-Fi. Dans la masse sonore offerte, dans cette chair
pulsative où chaque musicien tranche, l'auditeur perçoit vraiment qui fait quoi
et comprend les mécanismes à l'oeuvre. La guitare fouettée d'accords vifs et
moulinés du bras; la basse portant la rythmique et volant les soli; la batterie
en déferlements de roulements, atypique force de frappe dans le rock d'alors;
la voix haut perchée, puissante et inspirée.
Un must.
Les shows étaient brutaux, violents et énergiques,
déboulaient billes en tête. "Live
at Leeds" s'est voulu la restitution fidèle de ces moments furieux et hors
normes que plébiscitaient les fans. Ces derniers venaient pour un mur du son
dynamité. En conséquence, de nos jours, l'existence de Townshend est pourrie d'acouphènes qui en confréries de diables hurlants
perturbent ses sens via son ouie délabrée. Devant la scène, proches des amplis
rougeoyants, les spectateurs sentaient les bouchons de cérumen tressauter dans
les cages à miel. 116 décibels détectés au Charlton Athletic Football Ground en
1976: ambiance d'aéroport, DC9 à l'atterrissage, Opération Destop au coton-tige
en cours.
"Make it loud, play
it loud".
Les décibels frétillaient sur la peau des tympans,
déstabilisaient l'équilibre des osselets. Les notes chahutaient en fête folle
dans l'oreille interne. La scène livrait de la lave en fusion, des riffs
martelés sur l'enclume. C'était l'époque des décibels non bridés. Oubliez les
boules Quiès, livrez-vous au raz de marée sonore, submersion en prévision. Townshend et consorts marteau-piquaient
sans trêve ni repos; les tympans frissonnaient comme des peaux de tambour; le
gros son des amplis repoussait les corps refluant sous leur souffle invisible.
C'était un autre temps, celui de l'insouciance, celui d'une liberté en tout
espérée et recherchée, mais qui avait ses limites: la nécessité simple
d'instaurer un seuil maximal de puissance sonore s'imposa vite et fut un des
premiers signes que tout n'était pas possible.
Townshend, sur "Live at Leeds", au-delà de
la bande-son seule qu'offre le LP, se laisse deviner sur scène, ce soir d'il y
a 50 ans, comme lors de tous les shows de cette époque, en salopette blanche,
longue et maigre silhouette disloquée.
Certains clichés photographiques célèbres lui offrent la
postérité visuelle.
Sous les flashs frénétiques, brusques, saccadés et pulsatifs
des sunlights blancs stroboscopiques, Townshend
se fige tour à tour dans des postures acrobatiques et improbables le montrant:
_bondissant dans les airs tel un pantin blanc dégingandé, un
long phasme pâle disloqué. Ses jambes écartées sont posées sur un vide
invraisemblable. Il défie l'équilibre et la raison. Son bras droit dressé à la
verticale semble le montrer accroché aux étoiles pour l'éternité;
_ l'instant suivant: giflant les accords sur sa six-cordes
de moulinets incessants, toutes griffes dehors labourant l'air, le fouettant
d'arabesques circulaires improbables. Il présente la pulpe de ses doigts nus
sur le hachoir des cordes tendues, cravache sa guitare comme la croupe d'une jument
lors d'une réunion hippique, invente le moulin à vent guitaristique.
_On le voit encore sillonnant la scène comme le fit Chuck
Berry de son pas de canard légendaire.
Townshend, comme
toujours, presque techniquement incapable d'un solo digne de ce nom, ne délivre
à ce titre que de courtes excroissances ébouriffées issues de la rythmique en
cours, des traînées sonores déchirées, aussitôt nées aussitôt envolées qui
passent pour soli. Elles sont brèves et évanescentes; à ce titre elles
renforcent les qualités rythmiques hors pair du guitariste. Townsend est un monolithe rythmique
implacable, un guitar-hero atypique loin des stéréotypes de l'époque: il n'a
pas l'exubérance d'Hendrix mais le supplante en énergie brute.
John Entwistle:
sa basse est prégnante, ronde et ronflante; c'est une chatte qui quelques fois
ronronne et à d'autres se montre furibarde mais néanmoins diserte; elle est
omniprésente et technique; elle s'impose, prend ses quartiers, fait le job. On
va retrouver Entwistle sacré,
d'année en année, meilleur bassiste au monde dans le magazine musical français
"Best"
L'homme tire de ses doigts vifs et rapide sur le manche de
sa basse le surnom de "Thunderfingers"
Entwistle, toujours
immobile sur scène, fait sentinelle et surveille la cour d'école, l'imprévisibilité
de Townsend et de Moon (des scènes backstage et des
chambres d'hôtels saccagées en ont fait les frais) doit être contenue et
dirigée contre vents et marées. Il est le socle, l'assise, assume le poids de
la formation. Il sait porter un morceau rythmiquement, possède aussi un talent
soliste indéniable né de sa virtuosité, remplace le guitariste dans ses
faiblesses, inverse les rôles quand sa basse part en solo. Le monde à l'envers.
Daltrey aux
vocaux se pose en chanteur hard-rock typique de l'époque et rejoint les poses
et gimmicks alors en vogue de Plant
(Led Zeppelin) et de Gillan (Deep
Purple). Je le perçois comme l'élément le moins hors normes des Who et pourtant sa patte est
indispensable au son du groupe: il est Tommy,
sa voix puissante et énergique.
Le jeu de Moon à
la batterie, à l'égal de Townshend
et Moon, est lui aussi peu
conventionnel et atypique: des roulements décalés/décramponnés du tempo, un
show solo à lui tout seul tout du long du concert.
Cette volonté de démarcation regroupe dans le même état
d'esprit chacun des membres du groupe: une personnalité forte associée à chacun
d'entre eux. Le groupe ne fait qu'un dans une totale diversité, uni et inspiré dans le plus
difficile à mettre en oeuvre: la quasi presque impro de chaque instant..
The Who, à cette
époque, délivrait des moments uniques et magiques, suspendus dans la magie
visuelle et sonore de shows à nuls autres pareils. Pour en avoir vécu un, un
dimanche après-midi de 1974 à Lyon, je témoigne: le groupe était à la hauteur
de sa réputation. Pas de calcul, du direct, des coulées de lave sonore taillées
dans le plomb fondu. Le concert est resté gravé dans ma mémoire, ce ne fut pas
le meilleur de tous ceux vus mais à coup sûr le plus énergisant. J'ai eu la
chance de les voir à l'apex de leur renom. Après "Quadrophénia" il n'y eut plus qu'un lent déclin, leur scène se
peuplant des mêmes gestes scéniques sans cesse réitérés, vidés de toute
signification au regard des mots de leur vieux hit "My genération". Le groupe n'était alors plus crédible, la
nostalgie ne fait pas tout.
"I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my
generation)"
* C'est même le début de l'Age d'Or des bootlegs, ces
enregistrements pirates de concerts vendus à prix prohibitifs sous le manteau.
Le son est souvent pourri, les illustrations sont réduites à l'art le plus
simple. La première version officielle de la pochette de "Live at
Leeds" en 33 tours se limite à un tampon encreur frappant le haut droit de
cette même pochette, rien d'autre.
The Who - Live at Leeds - My Generation
Tracklist Version 33 tours 1970, pressage français
Face A:
01. Young
Man Blues (04'45'')(Mose Allison)
02. Substitute (02'05)(Pete Townsend)
03 & 04.
Summertime Blues (3'22)(Eddie Cochran/Jerry Capehart) + Shaking All Over
(4'15)(Reddy Heath)
Face B:
01. My
Generation (14'27'')(Pete Townshend)
02. Magic
Bus (07'30)(Pete Townshend)



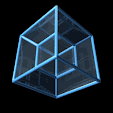











un excellent album
RépondreSupprimerOui. Et comment..! J'en ai deux exemplaires vinyle: le premier acquis usé comme dentelle du Puy sous les passages réitérés du saphir de la platine.
SupprimerChroniquer un album des Who le long de toutes ces années de carrière impose un choix qui s'infléchit vers les années au cours desquelles je les ai suivi. En gros de "Tommy" à "Who are You". Deux sont partis à la trappe, les deux opéras-rock, car trop léchés et éloignés de ma perception brute du rock (je les apprécie néanmoins). Les derniers du créneau (Who by numbers & Who are you) me paraissent moins bons comme à la traine du succès. "Who's next" est bon de la pirouette "2001 odyssée de l'espace" de l'illustration de pochette iconoclaste à l'excellence des morceaux. "Live at Leeds" est chef d'oeuvre.
Je suis curieux. Qui es-tu inconnu..? :-)
Supprimer